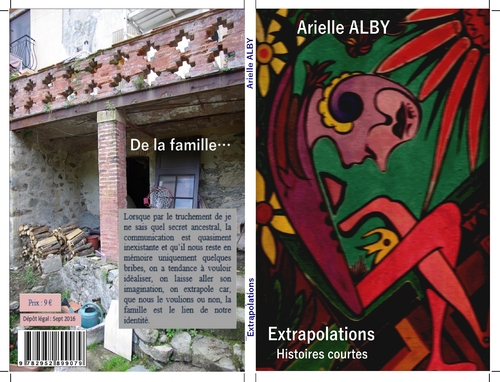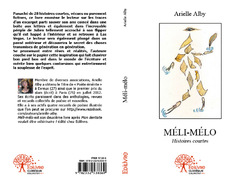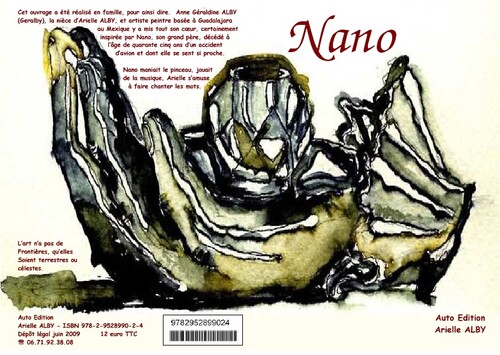-
Certains d'entre vous connaissent déjà ce récit pour avoir lu mon autobiographie. J'en ai fait une nouvelle pour que ma petite soeur ne soit jamais oubliée.
 J’étais très heureuse que ma petite sœur soit dans la région. Nous étions fermement soudées depuis la plus tendre enfance. Elle logeait dans un foyer pour travailleurs immigrés, en périphérie de la ville et avait trouvé un job de pompiste. J’avais beaucoup de peine de la voir dans cet environnement. Ce foyer était un vrai coupe gorge ! Ayant depuis peu mon appartement à Colombes et n’ayant pas encore restitué celui de Clichy, je proposais à Ghislaine d’habiter Clichy. Nous ne ferions pas les formalités, ainsi elle aurait juste à s’installer sans frais. Nous n’avions pas prévu que son meunier la retrouverait. Il débarqua à Senlis avec sa GS marron immatriculée en corse. Il n’était pas question que Ghislaine revienne sur sa décision de divorcer. Elle céda sa chambre à Léonard - son meunier de mari - et s’installa à Clichy. Je tremblais pour elle. « Tu n’as pas peur qu’il te fasse des ennuis ? » « qu’est ce que tu veux qu’il me fasse ? C’est un petit vieux. Il me fait pitié plus qu’autre chose ». J’avais vraiment un mauvais sentiment.
J’étais très heureuse que ma petite sœur soit dans la région. Nous étions fermement soudées depuis la plus tendre enfance. Elle logeait dans un foyer pour travailleurs immigrés, en périphérie de la ville et avait trouvé un job de pompiste. J’avais beaucoup de peine de la voir dans cet environnement. Ce foyer était un vrai coupe gorge ! Ayant depuis peu mon appartement à Colombes et n’ayant pas encore restitué celui de Clichy, je proposais à Ghislaine d’habiter Clichy. Nous ne ferions pas les formalités, ainsi elle aurait juste à s’installer sans frais. Nous n’avions pas prévu que son meunier la retrouverait. Il débarqua à Senlis avec sa GS marron immatriculée en corse. Il n’était pas question que Ghislaine revienne sur sa décision de divorcer. Elle céda sa chambre à Léonard - son meunier de mari - et s’installa à Clichy. Je tremblais pour elle. « Tu n’as pas peur qu’il te fasse des ennuis ? » « qu’est ce que tu veux qu’il me fasse ? C’est un petit vieux. Il me fait pitié plus qu’autre chose ». J’avais vraiment un mauvais sentiment. J’avais retiré mon fils du pensionnat et il avait réintégré l’école de Clichy où il retrouva avec joie son petit pote magrébin avec lequel il faisait les quatre cent coups. Lorsque Ghislaine est arrivée, nous avons décidé de laisser Cyril finir l’année scolaire à Clichy. Ainsi, je l’emmenais tous les matins et il rentrait le soir chez ma soeur. Il avait la clef et ne m’attendait qu’une heure à peu près, le temps que je rentre de mon travail. C’était une solution pratique. J’invitais souvent Ghislaine à manger chez moi. Lorsque son meunier était là, je le recevais aussi, mais à contre cœur. Nous avons passé les fêtes de fin d’année ensemble. Léonard, à priori, se sentait bien dans mes pénates et il commença à me faire des avances. J’étais scandalisée ! J’avais de plus en plus de mal à l’accepter dans ma maison. Fort heureusement, il rentra en corse après les fêtes et je poussais un OUF de soulagement. J’étais moi-même en pleine procédure de divorce et avisais ma petite sœur des tracas que cela occasionne. Elle n’avait pas d’enfant et ne s’inquiétait pas, mais elle avait quand même mis toute l’assurance vie de maman pour sauver la châtaigneraie de son mari et je savais que là, il y aurait comme un os ! Léonard ayant réintégré sa patrie chérie, nous passions de bons moments. Ghislaine avait reprit les études et s’initiait maintenant au sanscrit. Comme à l’ordinaire, elle s’était mis de la crème sur le visage avant de partir à son cours. Elle prenait soin de son corps et de son âme et cette image est restée gravée à jamais dans mon esprit. Elle me laissa son cartable noir et me donna rendez vous pour tard dans la soirée. La nuit est déjà bien sombre et elle n’est pas rentrée. Je trouve cela étrange mais je me dis qu’elle est certainement quelque part avec des amis. Je me couche. Dans cette nuit du huit au neuf avril 1983, à quatre heures précisément, je me réveille en sursaut. Je suis assise sur mon lit, les yeux grands ouverts et j’ai une image devant moi : deux têtes de squelette. Une est une tête de mort comme on en voit dans les musées et l’autre est une tête de mort avec les yeux vivants. J’ai peur, je crains qu’il ne soit arrivé quelque chose… Je ne peux pas la joindre car il n’y a pas le téléphone à Clichy et l’ère des portables n’en est qu’à ses balbutiements. Me voilà donc coincée, impuissante, totalement dépendante du temps qui me file entre les doigts. Je n’ai plus qu’à espérer qu’elle va rentrer, au moins venir chercher son cartable. Dimanche soir : toujours rien. Aucune nouvelle. Lundi matin, j’emmène mon fils à l’école et bien évidemment, je suis prise par ce temps qui passe à une allure folle. Si je monte à l’appartement, je vais arriver en retard au boulot. Tant pis, j’irais ce soir. Je me dis que j’ai tort de m’alarmer. Je tente de me raisonner. La journée est terriblement longue. Je ne pense qu’à ma petite sœur. Dix sept heures : je fonce au volant de ma petite auto. J’imagine que mon fils doit déjà être à l’appartement et me demande bien s’il est avec Ghislaine ou s’il est tout seul. Je grimpe quatre à quatre l’escalier en colimaçon. J’entends du bruit sur le palier. Cyril est là, entouré de deux policiers. « Que se passe t il ? » « Qui êtes vous ? » « Je suis Arielle ALBY, ma sœur habite ici et le petit garçon est mon fils » « Non, Madame ! Arielle ALBY habite ici ! Montrez nous vos papiers ». J’obéis. « Expliquez nous ! Qui est dans cet appartement ? » Je relate toute l’histoire et m’efforce de faire entrer dans ces deux crânes képités, que j’ai prêté le logement à ma sœur, pour la dépanner. « Je peux entrer maintenant ? » « Non Madame ! il y a eu un drame. On ne doit rien toucher et vous ne supporteriez pas et votre fils non plus, de voir le spectacle qui s’offre dans la salle de séjour » « J’en étais sûre ! » « Comment ça ? Vous savez quoi ? ». Les policiers étaient loin de s’imaginer que j’avais eu une vision en pleine nuit. « je ne sais rien ! Mais elle devait venir chez moi hier et je m’inquiétais » « suivez nous au poste ». Les deux policiers nous emmènent et un commissaire nous reçoit. Il n’en n’a rien à faire de notre douleur, nous passons à l’interrogatoire tel des criminels. Je m’énerve « ma petite sœur vient d’être assassinée et vous nous soupçonnez ! Vous ne voyez pas notre chagrin ? Vous feriez mieux d’épargner ça à mon fils et de tenter de trouver où contacter mes sœurs car je n’ai pas leurs coordonnées. Vous pourriez aussi m’expliquer ce qui s’est exactement passé ». L’homme à la pipe changea enfin de tactique et se mit à la recherche de mes frangines, après m’avoir indiqué que Léonard avait fait le trajet en train de Corse à Clichy. Acte prémédité ou simple dispute conjugale ? Je connais ma sœur : elle lui aura ouvert sa porte sans se méfier. Apparemment elle était en train de faire à manger et coupait du chou avec un grand couteau. Ghislaine aimait les couteaux. Elle m’en avait offert de beaux dans le passé. Léonard l’a égorgée comme on égorge les moutons dans la montagne corse. C’était un geste habituel pour lui. Je ne sais pas si elle a souffert. Elle a juste porté ses mains à sa gorge et s’est vidée de son sang. C’est lui qui a prévenu la police. Il est descendu dans la rue, a arrêté une voiture pour signaler un meurtre puis est remonté s’allonger auprès de Ghislaine et a feint le suicide. Voici exactement la vision que j’avais eue à quatre heures du matin, au moment même où Ghislaine décédait….deux têtes de mort, l’une vide, l’autre avec des yeux vivants. Il était évident que les policiers n’avaient pas cherché à me joindre puisqu’ils pensaient que c’était moi la victime, le logement étant resté à mon nom. Ce sont les voisins qui ont failli avoir une crise cardiaque lorsqu’ils m’ont vue traverser la cour ! Je n’oublierais jamais ce tableau nonchalamment posé à la tête du lit de Ghislaine et représentant une scène de la Bible, parfaitement peinte par papa lorsque nous étions enfants : trois païens agenouillés se faisant trancher la gorge ! Et cette « photomaton » que Ghislaine avait faite quelques jours avant son décès et où on ne voyait que son visage et ce lacet noir - très à la mode à cette époque - semblant lui serrer le cou ? Et cette bohémienne, qui un jour en présence de mon autre sœur annonçait à maman qu’une de ses filles mourrait d’un coup de couteau dans le dos ! Léonard a t il vraiment voulu se suicider ou bien était-ce une stratégie ? Il a été immédiatement transféré à l’hôpital de la prison de Fresnes.
Notre avocate était corse et heureusement ! Car elle nous a évité bien des pièges. Il s’en est fallu de quelques heures pour que Léonard s’évade de l’hôpital et s’enfuie dans le maquis. Notre avocate connaissait toutes ces ficelles et le plan échoua. Il fut incarcéré et la procédure se mit en route. Nous avons dû nous porter partie civile. Nous avons vite été envahies par des journalistes à scandale…..vous savez ! Ces magazines qui se prennent pour des détectives, pour ne pas les nommer. Pour les besoins de l’enquête, ma petite sœur a été autopsiée, c’est à dire qu’en plus de notre chagrin, il a fallu subir le fait qu’elle soit découpée de long en large, histoire de voir si elle n’avait pas pris de drogues ou boissons alcoolisées… Après l’autopsie, elle a été transférée au funérarium de Paris. Ah ! Ils l’avaient bien préparée ! Tout juste si elle n’était pas pomponnée et prête à sortir… j’en avais des hauts de cœurs car il ne fallait surtout pas relever le drap qui cachait les traces de la science infuse. Nous n’avions évidemment pas l’argent nécessaire pour l’enterrement. De plus, nous devions faire transporter Ghislaine à Castelnaudary dans l’Aude, pour qu’elle puisse reposer en paix auprès de papa et maman, notre caveau de famille se situant là bas. Il ne restait qu’une place dans le caveau, comme si Ghislaine était attendue. Il fallait donc se débrouiller pour réunir les fonds nécessaires. Nous ne pouvions compter que sur nous mêmes, la famille n’ayant cure de nos soucis malgré la compassion hypocrite manifestée lors de l’annonce de cette terrible nouvelle. Nous sommes fin prêtes pour le transport du corps. Ghislaine aimait beaucoup une plante que j’avais chez moi, alors j’ai fait une bouture pour mettre sur sa tombe. Me voilà installée à l’arrière du corbillard, tout près du cercueil. Je pose ma main dessus. Tout au long de la route, j’avais le sentiment que Ghislaine me serrait les doigts. J’en avais mal aux phalanges ! Je lui parlais doucement. Arrivées à destination, mon oncle nous attendait avec le reste de la famille. L’enterrement devait avoir lieu le lendemain. Cette fois ci, mon oncle nous logea sans problème. Il était très affecté. Il nous confia que Ghislaine avait habité chez lui durant trois mois avant sa montée à Paris. Elle était venue se réfugier là quand elle a quitté Léonard. Ainsi, elle se sentait protégée. C’est le seul moment où notre tuteur a fait quelque chose de concret pour nous, ses deux nièces mineures, et il s’en voulait énormément de ne pas avoir agi plus tôt. Durant ces trois mois, il s’était aperçu que tous ces aprioris de la famille, étaient faux, déplacés et injustes. Sa conscience en avait pris un sacré coup et il en avait gros sur la patate. Le lendemain matin, toute la petite ville suivait le cortège. Chacun nous serra la pince avec un œil compatissant. Il me tardait que ce cinéma se termine. Chez tonton, un cahier de doléances avait été installé dans la petite entrée carrelée. Et la vie reprit son cours…
La reconstitution eut lieu quelques mois plus tard. Une tripotée de policiers se tenait entre Léonard et nous, car on aurait pu vouloir se venger. Ils avaient raison de monter la garde : j’avais vraiment la haine et de mauvaises pensées me traversaient l’esprit. Cette reconstitution me fut très douloureuse, d’autant plus que je revoyais Léonard pour la première fois depuis le meurtre. Il n’a jamais osé me regarder en face. L’enquête suivait son cours, nous sommes rentrées chez nous. Trois années se passèrent. Je commençais à peine à faire le deuil et ma douleur s’estompait quand nous recevons une convocation des assises. Je ne comprendrais jamais comment l’instruction peut durer aussi longtemps. Sur les marches du tribunal, j’ai le cœur qui bat la chamade. Je vais être citée comme témoin. Nous prenons place au premier rang. Les avocats des deux parties sont là. Dans les bancs du fond, se tiennent des gens que je ne connais pas mais qui pourraient bien être la famille corse. Ils sont tout de noir vêtus et encadrés par deux gendarmes. A l’avant, une sorte de grand comptoir vide. Nous devons rester debout jusqu’à l’arrivée des magistrats. Mes genoux suivent mon cœur de près et on les entend presque jouer des castagnettes ! Il est temps que je m’assieds. Les jurés font leur entrée. Les gendarmes, droits comme des gratte-ciel, surveillent les moindres gestes. Un silence lourd pèse sur la salle. J’ai chaud. Môsieur l’avocat principal, de sa robe couleur corbeau vêtu et jetant nonchalamment son écharpe par dessus son épaule comme si, d’un mouvement de tête en arrière, il remettait en place sa mèche rebelle, Môsieur traversa dignement l’allée entre jurés et partie civile, pour finir sa course dans un box où tel un cheval, il sembla se cabrer. On sentait l’élite ! Le juge apparut et déclara « faites entrer l’accusé », puis il posa son popotin et nous en fîmes de même. J’étais très impressionnée, limite malaise ! Le box de l’accusé était en diagonale par rapport à ma place. De ce fait, je voyais en permanence Léonard. L’avocat général commença sa plaidoirie. Il nous vanta le beau pays qu’est la corse ! Je rêve ! Il nous fait quoi « Môsieur » ? Puis il enchaîna sur un réquisitoire à faire pâlir les pro de la jactance. Il palabra durant environ trois quart d’heure et là…chapeau, M’sieurs dames ! Une vraie pièce de théâtre ! Puis vînt à la barre le médecin légiste. Il nous détailla à nouveau sous quelles coutures il avait coupé ma petite sœur en morceaux, pour en final, nous annoncer qu’il n’avait rien trouvé de suspect. On a même eu le droit de revoir les photos de Ghislaine, nue et gisant dans son sang. Voilà comment trois années après un drame, on vous remue le couteau dans la plaie, à peine cicatrisante ! Puis, les deux avocats prirent la parole, l’un pour défendre, l’autre pour accuser. Ce fut mon tour de témoigner. « Présentez vous, dites « je jure de dire la vérité, toute la vérité ». Dans un balbutiement, j’arrive à sortir quelques mots « parlez plus fort, on ne vous entend pas ! ». Si vous saviez comme j’étais malheureuse ! Comme j’avais peur de parler en public ! J’étais terrorisée. On me posa mille questions auxquelles j’ai répondu, toujours en regardant Léonard droit dans les yeux, pour bien lui montrer ma déchirure. Môsieur l’avocat général termina la séance et Léonard fut condamné à douze années de prison fermes, plus dommages et intérêts. Les gendarmes emmenèrent Léonard menotté. A la sortie du tribunal, sa famille vint nous présenter des excuses les plus plates. La sincérité se lisait sur leurs visages. Ceci m’a beaucoup émue. Pour ma part, j’ai trouvé qu’une peine de douze ans était trop juste si on considère les dégâts occasionnés sur notre psychisme. Je pense que la peine n’a pas été plus lourde en raison de l’âge avancé de Léonard. Quoiqu’il en soit, le principal n’est pas tant la longueur de l’emprisonnement, mais plutôt que justice ait été rendue………quand on pense qu’il aurait pu se sauver dans le maquis !
Ma soeur aînée fréquentait alors l'église évangélique de pentecôte et disait qu'il fallait pardonner. Je n'en n'avais pas la force et ne partageais pas ses idées. Elle allait rendre régulièrement visite à Léonard en prison. Je ne sais pas cmment elle s'y est prise mais il est vite devenu le bras droit de l'aumônier et a été libéré pour bonne conduite au bout de sept ans.
Bravo la manip de la frangine !
 1 commentaire
1 commentaire
-
Tableau de Sybil Aubin
Je suis l’alpha et l’oméga,
La renaissance,
L’âme éternelle,
Je perpétue la vie.
 1 commentaire
1 commentaire
-

Je longeais à petits pas
L'arène en forme de trèfle
Où les cris de joie
Des enfants sonnaient telles des trompettes.
L'arbre éléphant,
Paisiblement barrissait
Tout en me lorgnant.
Je fus plongée dans mon passé.
La petite fille aux yeux violets,
Chevelure brune au vent, ondulée,
Bravait tous les dangers
Sur sa balançoire, envolée.
Pirouette, cacahuète !
A la limite du saut périlleux,
Propulsée vers son espace céleste,
Elle fit trois tours et hop ! Petite peste ...
Sur le toboggan, la petite blonde
Marchait, remontant le courant.
Je fus saisie une seconde
Par le souvenir, jambe cassée, de mon enfant.
Mes yeux se posèrent sur le tourniquet
Où jadis, j'attrapais le hoquet.
Dans le petit train me cachant,
Je revins au présent.
Jeux d'enfants, jeux d'antan,
Jeux joyeux, m'enivrant.
 1 commentaire
1 commentaire
-
 L’heure, le temps, le réveil. Chaque matin, j’ai rendez vous avec la pointeuse. Qu’il neige ou qu’il vente, elle reste exactement implacable. Elle n’est pas vieille et pourtant manque de souplesse. L’heure, le règlement, le travail.
L’heure, le temps, le réveil. Chaque matin, j’ai rendez vous avec la pointeuse. Qu’il neige ou qu’il vente, elle reste exactement implacable. Elle n’est pas vieille et pourtant manque de souplesse. L’heure, le règlement, le travail. Cinq heures trente, six heures…. Je me lève d’un bond, je suis en retard. Les yeux à demi clos, je stresse déjà, je fais tout et n’importe quoi, je me dépêche, je n’y arrive pas. L’horloge, les embouteillages, l’énervement. Mon petit déjeuner tente de me secouer, en vain. Les clips vidéo défilent à la télé, puis les informations. Mince ! Il est six heures quarante. Je me hisse avec lenteur et lourdeur hors de mon canapé : il faut que je prépare ma gamelle. Mais qu’y a-t-il donc dans le réfrigérateur ? Ah ! Un reste de salade, une côte de porc à la moutarde, du fromage. Bon, ça fera l’affaire. Je ne dois surtout pas oublier les petits gâteaux, j’aime bien grignoter dans la voiture, ça passe les nerfs lorsque je suis bloquée parmi les centaines d’automobiles et que le compteur tourne à une vitesse affolante. Il est bien le seul à avancer.
J’allume le chauffe eau pour prendre ma douche et profiter un peu de la chaleur sur mes vieux os. Me dérouiller, me débarbouiller, gestes essentiels pour bien démarrer. Et voilà pas qu’au beau milieu de mon plaisir matinal, je tombe en panne de gaz. Les larmes me montent aux yeux et se confondent avec les gouttelettes encore perlant sur mon visage. J’enfile un peignoir et c’est les cheveux mouillés, bravant la nuit et le froid, que j’use de ma clef anglaise pour dévisser le détendeur. Je retourne finir ma toilette. Je suis de plus en plus en retard et je sais que je vais avoir des problèmes. J’enfile mes chaussettes et mon parka. Ma petite auto me tend les bras. Elle est gelée, elle aussi, il faut que je gratte le pare brise, que j’évacue cette buée qui traîne encore d’ailleurs sous mes lunettes. Tard, trop tard, il est trop tard ! Pourvu que ça roule, pourvu qu’il n’y ait pas d’accrochage sur l’autoroute, pourvu….. Mon Dieu ! Je prie. Je suis obligée d’aller lentement pour sortir de mon terrain de camping sinon la gardienne grogne. Je suis ralentie par le chemin caillouteux et bosselé. C’est la sente des agriculteurs qui n’ont cure de mes frayeurs. Ils passent aisément avec leurs tracteurs.
J'arrive enfin près de l’école. Mon petit village est très agréable avec ses rues étroites et ses vieilles pierres. Qui dit ruelles, dit qu’au moment de la rentrée des classes, il y a forcément un bouchon pour laisser passer les p’tits bouchons. C’est pour la bonne cause, alors je patiente et me régale de toutes ces petites bouilles encore endormies mais prêtes à assumer leur journée de travail, elles ! Puis je me mets à la recherche du temps perdu et file tout droit jusqu’au carrefour, tout en bas, là où la civilisation semble sortir d’on ne sait où. Oh la la ! Il y a du monde ce matin : impossible de franchir le croisement. Ca défile à droite, ça défile à gauche. Pas de répit, brouillard, retard. Pas de courtoisie non plus, chacun se presse.
J’avale les quatre kilomètres restant, ne prenant même pas une toute petite seconde pour admirer la campagne. Me voici au rond point fatidique : celui qui me mènera tout droit sur l’A15. On avance, on avance, on avance ! Ouf, la voie express semble dégagée. J’ai bien récupéré au moins, cinq bonnes minutes si précieuses. J’enquille l’autoroute, tente de me déporter sur la troisième file, évitant ainsi le blocage vers Eragny. Je me fais de belles frayeurs, les gens au volant, sont si dangereux. La vitesse, la peur, l’angoisse, sans compter cet énergumène qui me colle au train, s’imaginant que ma Clio va trouver des ailes. Le pas à pas passé, je me repose un peu. La voie est libre, j’entame les gâteaux secs. Juste après la station d’essence sur ma droite, je lis le panneau lumineux fixé en hauteur « A15 > A86 : une heure trente – A15 > D7 : bouchon ». Je n’en crois pas mes yeux, il doit y avoir une erreur, leur panneau n’est pas à jour, c’est tellement fluide à cet instant présent ! Je n’ai pas fini ma réflexion que la réalité s’impose : j’aperçois des warnings à moins de cinq cent mètres. C’est fichu. La prochaine sortie est loin, je ne peux pas bifurquer. Coincée, peinée, désabusée.
Que puis-je donc y faire ? Je vais devoir raser les murs sur le chemin de la pointeuse, on va me montrer du doigt, je vais rougir de honte, vouloir me cacher. Je devrais m’expliquer, on ne me comprendra pas, j’ai déjà eu deux avertissements pour ce même motif, un troisième serait fatal.
Oh, je pourrais bien tricher, prendre la bande d’arrêt d’urgence et doubler toute la file d’un coup. J’en vois qui le font sans scrupule mais bien souvent, ils sont rattrapés par la police et ne sont pas plus avancés. En rusant ainsi, ils ne font qu’augmenter les ralentissements, provoquant des accidents avec les motos qui jouent du slalom. La police fait bien son travail mais nous barre la route sans se soucier de notre déroute. Perte de temps, rage et tourments. Je pourrais imiter ma mère aussi, qui, jamais à l’heure, m’a transmis ce gène qui me gêne et que j’ai moi-même redonné à ma fille. Aucune discipline, fuir les contraintes, ignorer l’horloge. Ma mère, avec sa mini Austin, montait sur les trottoirs dans Paris, serpentant entre les platanes, pour gagner quelques mètres et minimiser son retard. Elle arrivait toujours à convaincre les gendarmes de sa bonne foi et a même réussi un jour, à se faire escorter sur les Champs Elysées, afin de ne pas rater un rendez vous de la plus haute importance. Il faut dire qu’elle était connue sur la place de Paris. Ma mère était dans les affaires et nous étions en 1970, juste après les combats novateurs et baba cool de la période hippie. Le gouvernement n’était pas aussi strict qu’aujourd’hui. Ma mère disait qu’à Paris, on se gare « à l’oreille » : un coup devant, un coup derrière et le tour est joué ! Dans la famille, nous ne savons pas gérer les embouteillages. Quelle horreur ! Mais tout le monde sait bien qu’en région parisienne, on est à l’heure… à un quart d’heure près.
Je me cherche des excuses car on pense que j’abuse. Je suis propulsée dans un monde irréel où mes idées vagabondent tandis qu’à mon travail, on me sonde. De toutes manières, sortir à la prochaine bretelle est complètement utopique. J’ai déjà testé ce parcours et me suis perdue dans des dédales de sens interdits, déviant de ma route et rallongeant mon temps de parcours. J’abandonne cette solution. Me sauver à la suivante, via Franconville, relève du délire également. Le rond point vers Ikéa, est en permanence bloqué et la traversée de cette ville est truffée de feux rouges. La circulation est bien trop dense pour pouvoir espérer y trouver une issue heureuse.
Il ne me reste plus qu’à patienter jusqu’à la sortie vers le moulin de Sannois. Au bout de quarante cinq longues minutes, j’atteins enfin cette échappée qui, je le sais, sera belle. C’est la destination miracle, celle où, trafic ou non, ça passe comme dans du beurre. Je joue de l’embrayage dans la longue montée. Les gens m’énervent ! Ils ne comprennent pas qu’à faire des dizaines de redémarrages en côte, ils ne doivent pas me coller. Je ne garantis pas le bon usage de mon frein à main et crains pour mon arrière train. Ca y est, je suis au sommet, au summum de l’ultime solution. Maintenant, ça descend tout droit, le seul petit barrage se trouve au prochain carrefour mais n’est pas méchant….. sauf que…. Je n’avais pas prévu qu’il y aurait des travaux !
Baisser les bras, verser quelques pleurs, la sueur avant le labeur. Je suis nerveusement épuisée, j’ai le sentiment d’avoir déjà dépensé l’énergie d’une journée entière.
Ah, ils choisissent bien le moment pour réparer la chaussée ! Je suis bernée, il ne me reste que quinze minutes pour être dans les clous et cet idiot de feu rouge mobile est lent à passer au vert. C’est d’autant plus irritant qu’en face, il n’y a personne. J’ai tellement envie de le griller, j’ai comme une pulsion de faire demi tour, prendre ma matinée, retourner profiter de mon jardin et gazouiller avec les petits oiseaux. Pourquoi faut-il qu’on se complique la vie, histoire de badger en tout bien, tout honneur ? N’y a-t-il pas d’autres moyens d’arriver au travail sans avoir la pression lorsqu’on habite une région bondée de monde ? Nous sommes dans un siècle de barbares. Je m’extirpe de mon escapade au vert lorsque ce fichu feu vire de couleur. Je fonce. Prise de risques, défoulement, agacement. J’y suis presque ! Pourvu que le pont d’Argenteuil ne soit pas chargé, lui qui tremble par le poids des camions, bus et cabriolets. C’est la dernière étape.
Aujourd’hui, il fait beau sur le pont malgré la grisaille de la pollution. Je tourne à droite, je me gare et gare à celui ou celle qui me freinera dans ma course ! Je ne suis pas d’humeur à plaisanter.
Je passe le tourniquet, j’accélère mon allure car j’ai encore une bonne dizaine de minutes avant d’atteindre, le bras tendu pour gagner une seconde, la pointeuse déconcertante. Il y a dix ans, j’aurais fait ce dernier bout de route en cinq minutes mais j’ai vieilli et mes pieds ne suivent plus mon cerveau. Ca non plus, ils ne le comprennent pas. Ils sanctionnent la vieillesse. Ne peut on pas me laisser finir ma carrière tranquille, dans un coin, sans me vouloir productive, moi qui ai trimé corps et âme depuis toutes ces années ? Je sais bien que c’est dans les vieux pots qu’on fait la bonne soupe mais je suis usée d’avoir à courir chaque matin. No pause, no répit, ménopause.
Je n’ai pas encore officialisé mon arrivée et les collègues m’abordent, me sollicitent, me happent dans mon élan, afin que je sois à l’écoute de leurs petites tracasseries car mon travail consiste à me mettre au service des autres. Je suis une star en quelque sorte mais ils me mettent en retard ! « Laissez moi pointer, on discutera après ! » et je file sans me retourner, laissant le client dans l’embarras. Ils ne saisissent pas mon désarroi, je suis tellement douce et agréable en temps ordinaire. Oui, mais là, j’ai la pression. Telle une cocotte minute, je vais cracher mon feu.
Poussée par cette vapeur ardente, j’entre dans le hall et elle est là, me regarde implacable, m’attend.
Neuf heures et 29 minutes : bip. Ouf ! Objectif atteint. J’ai bien mérité mon chocolat avant d’usiner. Je remercie le bon Dieu et le prie de bien vouloir renouveler ce petit miracle, m’aider à honorer mon rendez vous quotidien avec cette stupide machine qui ne sera jamais, au grand jamais, ma copine.
 1 commentaire
1 commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires